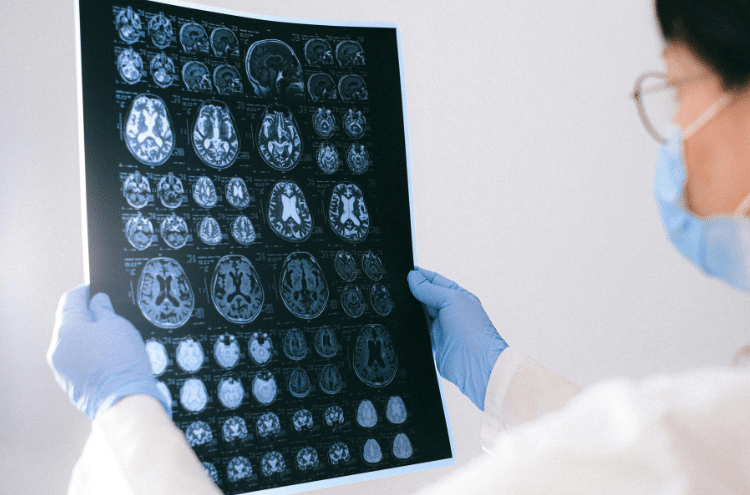Touchant 2 millions de personnes en France dont 10 % des personnes âgées de plus de 70 ans vivant à domicile[1], la dénutrition n’est pas une conséquence normale du vieillissement mais une véritable maladie chronique. Selon la Haute Autorité de Santé, la dénutrition se définit comme un déséquilibre nutritionnel profond, caractérisé par un manque de protéines et de calories qui affaiblit progressivement l’organisme.
Cependant, cette maladie peut être évitée et soignée lorsqu’elle est détectée à temps et prise en charge correctement. Comprendre ses mécanismes et savoir la repérer constitue donc un enjeu majeur pour préserver la santé et la qualité de vie de nos aînés.
Attention, il convient de ne pas confondre dénutrition et malnutrition. La malnutrition concerne principalement les carences en vitamines et minéraux, tandis que la dénutrition correspond à un manque global d’énergie et de protéines qui compromet le fonctionnement de l’organisme dans son ensemble.
Chez Emera, la lutte contre la dénutrition constitue un enjeu majeur de l’accompagnement des personnes âgées. Emera a développé des protocoles spécifiques d’enrichissement alimentaire et de surveillance nutritionnelle, adaptés aux différents degrés de dénutrition.
Comprendre les causes pour mieux prévenir
La dénutrition résulte rarement d’une seule et même cause, mais plutôt d’un ensemble de facteurs qui s’accumulent et s’aggravent mutuellement. Les troubles bucco-dentaires constituent l’une des principales portes d’entrée vers la maladie. Difficultés de mastication, mauvais état dentaire, prothèses mal adaptées ou douloureuses… autant de problèmes qui transforment progressivement les repas en corvée plutôt qu’en plaisir.
Les pathologies aiguës ou chroniques jouent également un rôle déterminant. Une infection, une fracture qui limite la mobilité, des troubles de la déglutition ou encore une constipation sévère peuvent rapidement dégrader l’état nutritionnel d’une personne âgée. Ces situations médicales s’accompagnent souvent de douleurs ou d’inconfort qui coupent naturellement l’appétit.
L’aspect psychologique et social comme l’isolement, le deuil, la dépression représentent autant de bouleversements émotionnels qui peuvent perturber les habitudes alimentaires.
Les traitements médicamenteux, bien que nécessaires, peuvent aussi favoriser l’apparition de la dénutrition. Certains médicaments provoquent une sécheresse de la bouche, modifient le goût des aliments ou causent des troubles digestifs. De même, les régimes restrictifs prolongés, qu’ils soient destinés aux diabétiques, aux personnes souffrant d’hypertension ou d’hypercholestérolémie, peuvent paradoxalement conduire à une dénutrition s’ils ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques de la personne âgée.
Reconnaître la spirale dangereuse
La dénutrition s’installe insidieusement selon un processus en spirale particulièrement pernicieux. Tout commence par une perte d’appétit qui peut sembler anodine. Cette diminution des apports alimentaires entraîne un amaigrissement progressif, lui-même responsable d’une perte d’énergie générale.
Cette fatigue pousse la personne à réduire ses activités physiques, ce qui affaiblit encore davantage ses muscles et sa condition générale. L’affaiblissement physique s’accompagne souvent de troubles de l’humeur : anxiété, tristesse, découragement viennent amplifier la perte d’appétit initiale.
L’organisme affaibli devient alors plus vulnérable aux infections. Les défenses immunitaires diminuent, ouvrant la porte aux complications : infections respiratoires, urinaires, escarres, chutes… Ces complications nécessitent souvent des hospitalisations qui aggravent encore l’état nutritionnel, créant un cercle vicieux difficile à briser.
Cette spirale descendante explique pourquoi il est essentiel d’intervenir dès les premiers signes. Plus la prise en charge est précoce, plus les chances de récupération sont importantes et rapides.
Établir le diagnostic avec précision
Le diagnostic de dénutrition repose aujourd’hui sur des critères précis établis par la Haute Autorité de Santé. Pour confirmer la maladie, il faut identifier au moins un critère phénotypique (signe visible) et un critère étiologique (cause identifiable).
Les critères phénotypiques regroupent les signes que l’on peut observer :
Du côté des critères étiologiques, plusieurs causes doivent alerter :
Évaluer la gravité de la situation
Une fois le diagnostic posé, il convient d’évaluer la gravité de la situation. La dénutrition est considérée comme modérée lorsque :
La dénutrition devient sévère quand :
Cette situation nécessite une prise en charge immédiate et renforcée.
La surveillance, clé de la prévention
Une surveillance régulière constitue l’arme la plus efficace contre la dénutrition. La pesée mensuelle de toute personne âgée à risque permet de détecter rapidement une perte de poids anormale. En cas de dénutrition avérée, cette surveillance doit devenir hebdomadaire pour suivre l’évolution et adapter rapidement la prise en charge.
La surveillance ne se limite pas au poids. L’observation des habitudes alimentaires, de l’appétit, de la fatigue ou encore des changements d’humeur fournit des indices précieux.
L’alimentation plaisir au cœur du traitement
La prise en charge de la dénutrition ne consiste pas à imposer une alimentation contraignante. Au contraire, l’objectif principal est de redonner envie de manger en privilégiant le plaisir gustatif et le respect des goûts personnels. C’est pour cela que les chefs dans les établissements Emera sont issus de la restauration traditionnelle.
Même si la personne souffre de diabète, la dénutrition devient la priorité absolue. Si elle désire une pâtisserie ou un produit sucré, il ne faut surtout pas l’interdire. Le plaisir alimentaire constitue le moteur principal du retour à une alimentation suffisante. Les besoins nutritionnels des personnes dénutries sont spécifiques. Il faut viser 30 à 40 kilocalories par kilogramme de poids corporel et par jour, ainsi que 1,2 à 1,5 gramme de protéines par kilogramme de poids.
L’enrichissement alimentaire consiste à augmenter la valeur nutritionnelle des plats sans en augmenter le volume. Les protéines se trouvent dans les viandes, poissons, œufs, produits laitiers, mais aussi dans l’association légumineuses-céréales. Pour les calories, on privilégie les matières grasses de qualité, les oléagineux comme les amandes ou les noix, et les produits sucrés selon les goûts de chacun.

Le fractionnement, une stratégie gagnante
Les personnes dénutries ont souvent perdu l’habitude de manger de grandes quantités. Le fractionnement des repas représente alors une stratégie particulièrement efficace. Au lieu des trois repas traditionnels, on passe à cinq voir six prises alimentaires dans la journée.
Concrètement, une journée type correspond à cela :
Cette répartition permet de proposer des portions plus petites et donc plus acceptables, tout en maintenant des apports nutritionnels suffisants sur l’ensemble de la journée. Chaque prise alimentaire devient ainsi moins intimidante et plus facilement consommable.
Adapter la prise en charge selon la sévérité
La stratégie nutritionnelle s’adapte au degré de dénutrition identifié, suivant une approche progressive basée sur les protocoles d’enrichissement.
Pour les personnes à risque de dénutrition dont les apports alimentaires correspondent encore à leurs besoins (par exemple, une personne de 70 kg qui consomme environ 2 100 kcal par jour comme recommandé), une simple surveillance renforcée avec pesée mensuelle suffit. C’est le protocole P0 selon l’arbre décisionnel développé par Emera. Si les apports deviennent insuffisants, on passe au protocole P1 avec un premier niveau d’enrichissement : ajout de crème fraîche dans les soupes, de beurre sur les légumes, ou de fromage râpé sur les plats.
En cas de dénutrition modérée, l’enrichissement devient plus systématique. Lorsque les apports couvrent encore plus des deux tiers des besoins (soit plus de 1 400 kcal par jour pour notre exemple de 70 kg), le protocole P2 d’enrichissement modéré peut suffire : compléments nutritionnels oraux entre les repas, enrichissement de tous les plats principaux, fractionnement en 5-6 prises alimentaires. Si ce seuil des deux tiers n’est pas atteint (moins de 1 400 kcal/jour), on applique d’abord le protocole P1 puis P2 en cas d’échec.
La dénutrition sévère requiert le protocole P3 avec une prise en charge spécialisée :
Prévenir le syndrome de renutrition inappropriée
Le syndrome de renutrition inappropriée représente l’un des écueils de la prise en charge nutritionnelle. Il survient lorsque l’organisme, après une période de privation, ne parvient pas à gérer correctement la reprise alimentaire. Cette complication se manifeste par des œdèmes, des dysfonctionnements d’organes et des déséquilibres dans le sang, notamment des chutes de phosphore, magnésium et potassium.
Ce syndrome s’explique par les adaptations que l’organisme a développées pendant la période de dénutrition. Habitué à fonctionner au ralenti, il se trouve brutalement sollicité par l’arrivée de nutriments et ne parvient pas à suivre le rythme. Les organes affaiblis peinent à assimiler correctement les apports, créant des déséquilibres dangereux.
La prévention passe par une renutrition progressive et une surveillance biologique rapprochée chez les personnes les plus dénutries. Les professionnels adaptent les apports selon la tolérance et corrigent rapidement les déséquilibres éventuels.
Une approche globale pour une prise en charge réussie
La dénutrition chez les personnes âgées ne se résume pas à un simple problème alimentaire. Elle nécessite une approche globale qui prend en compte tous les aspects de la vie de la personne : médicaux, psychologiques, sociaux et environnementaux.
La prise en charge des pathologies sous-jacentes, l’amélioration de l’environnement social, le maintien du plaisir alimentaire, le soutien des professionnels de santé et des proches constituent les piliers d’une récupération réussie. Cette approche humaniste replace la personne au centre des préoccupations, respectant ses goûts, ses habitudes et sa dignité.
[1] https://sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/semaine-nationale-de-la-denutrition-du-12-au-20-novembre-2021-tous-mobilises
[2] Cette complication peut survenir lors de la reprise alimentaire chez des personnes très dénutries, se manifestant par des œdèmes et des déséquilibres sanguins (chute du phosphore, magnésium et potassium).